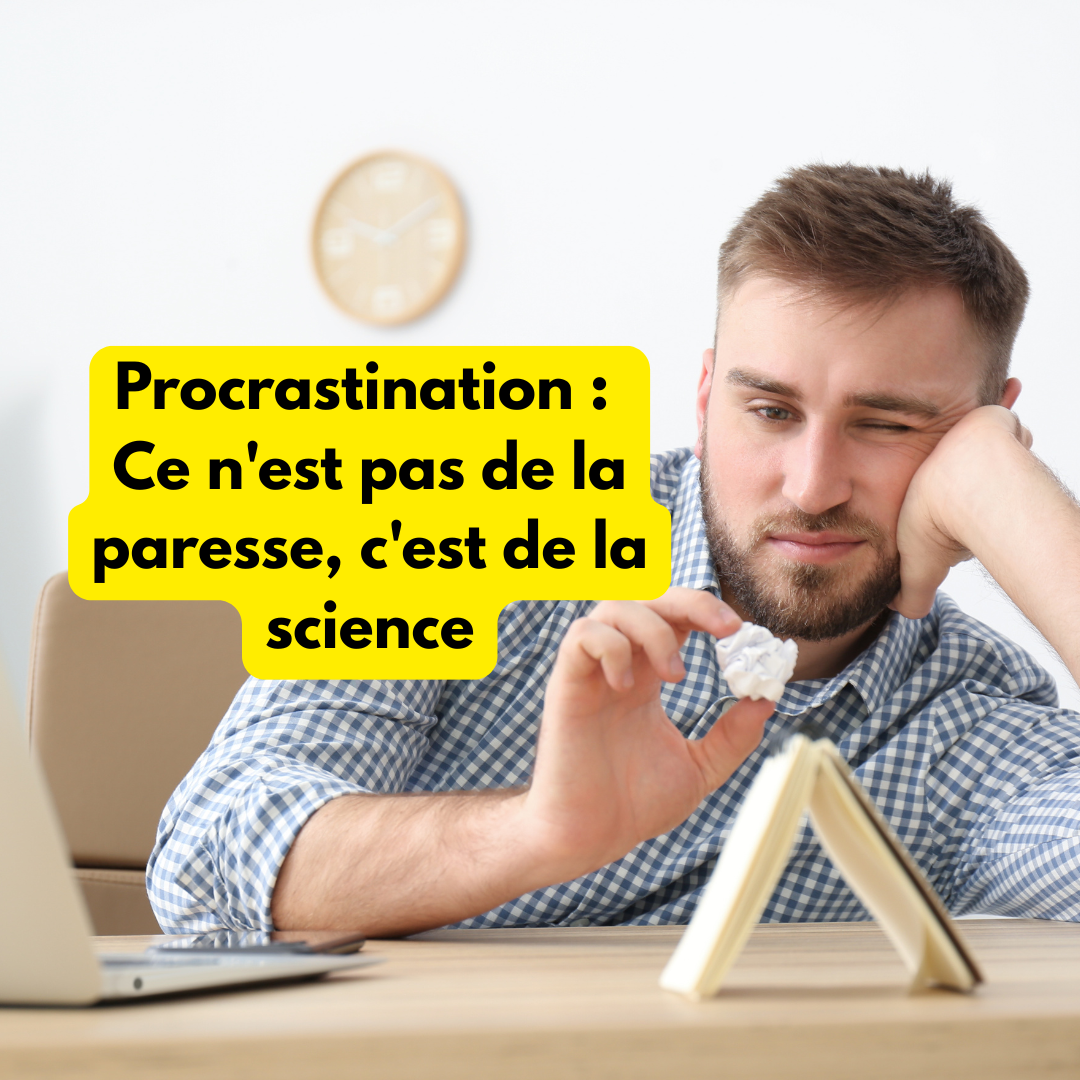La Procrastination : Plus qu’une simple paresse, une science de l’action
Nous l’avons tous fait. Cette tâche importante qui nous attend, ce projet à rendre, ce coup de fil à passer… et pourtant, nous nous retrouvons à faire tout autre chose. La procrastination, cette tendance à remettre au lendemain ce que l’on pourrait faire le jour même, est une expérience universelle. Mais est-ce simplement de la paresse ? La science nous dit que c’est bien plus complexe.
Le « fossé » entre l’intention et l’action
L’un des modèles les plus intéressants pour comprendre la procrastination est celui du « fossé intention-action ». L’idée est simple : il existe un espace, un vide, entre notre décision de faire quelque chose et le moment où nous passons réellement à l’acte. Ce fossé n’est pas dû à un manque de volonté, mais est influencé par trois facteurs principaux :
- Le coût d’entrée : C’est l’énergie nécessaire pour simplement commencer. Plus une tâche semble intimidante ou difficile à démarrer, plus le coût d’entrée est élevé.
- Le coût de maintien : Une fois la tâche commencée, quelle est la difficulté pour la poursuivre ? Si l’effort est constant et intense, il est plus probable que nous abandonnions.
- La récompense : Si le bénéfice de notre action est lointain ou incertain, notre motivation diminue. Nous sommes naturellement programmés pour préférer les récompenses immédiates.
Comment combler ce fossé ? La technique du « Chunking »
Alors, comment réduire ces coûts et enfin passer à l’action ? Une des stratégies les plus efficaces est de changer notre perception de la tâche. Plutôt que de voir une montagne insurmontable, il faut la découper en plus petites collines.
C’est la technique du « chunking » (ou « découpage »). Un projet qui semble énorme, comme « écrire un rapport de 50 pages », peut être découpé en petites actions beaucoup plus gérables : « faire le plan », « rédiger l’introduction », « chercher des sources pour la première partie », etc. Chaque petite tâche accomplie procure un sentiment de réussite et une petite récompense, ce qui nous motive à continuer.
La procrastination peut-elle être une bonne chose ?
Étonnamment, la réponse est parfois oui. Remettre à plus tard n’est pas toujours une mauvaise chose. On parle de « désengagement attentionnel » : choisir consciemment de procrastiner sur des choses qui nous causent du stress ou de l’anxiété peut être une forme de protection. Par exemple, si vous êtes stressé par une présentation à venir, passer du temps sur une autre activité peut vous permettre de revenir plus tard à votre tâche avec un esprit plus clair et moins anxieux.
En conclusion, la procrastination n’est pas une fatalité ou un défaut de caractère. C’est un mécanisme complexe lié à la manière dont notre cerveau évalue l’effort et la récompense. En comprenant ce qui se passe dans ce « fossé intention-action » et en utilisant des stratégies simples comme le découpage des tâches, il est tout à fait possible de reprendre le contrôle et de transformer nos intentions en actions concrètes.